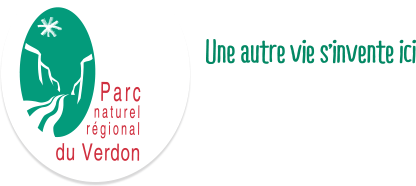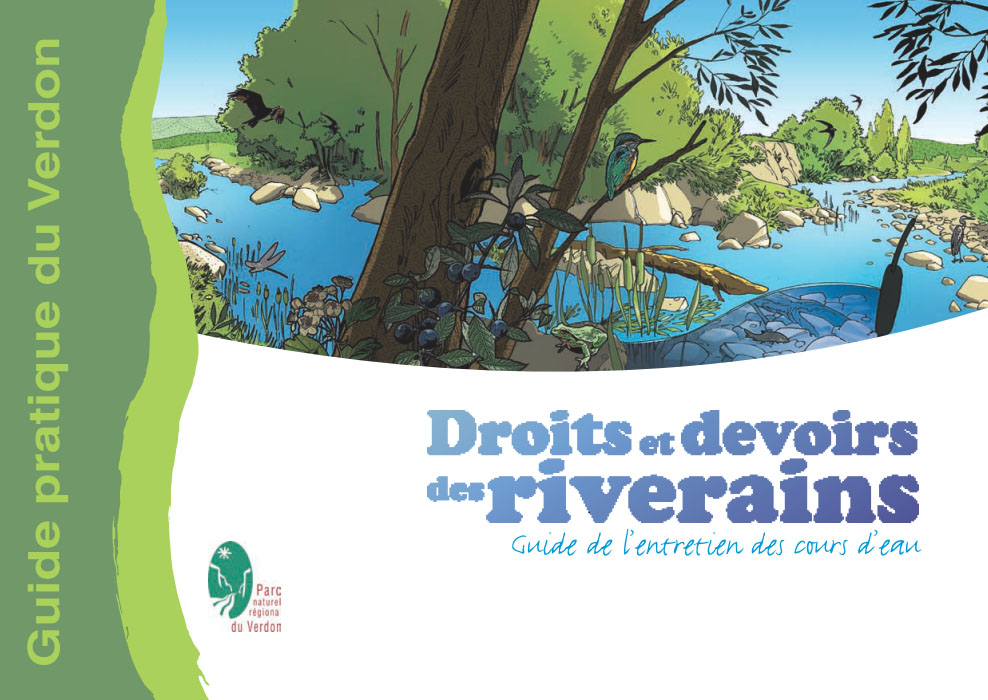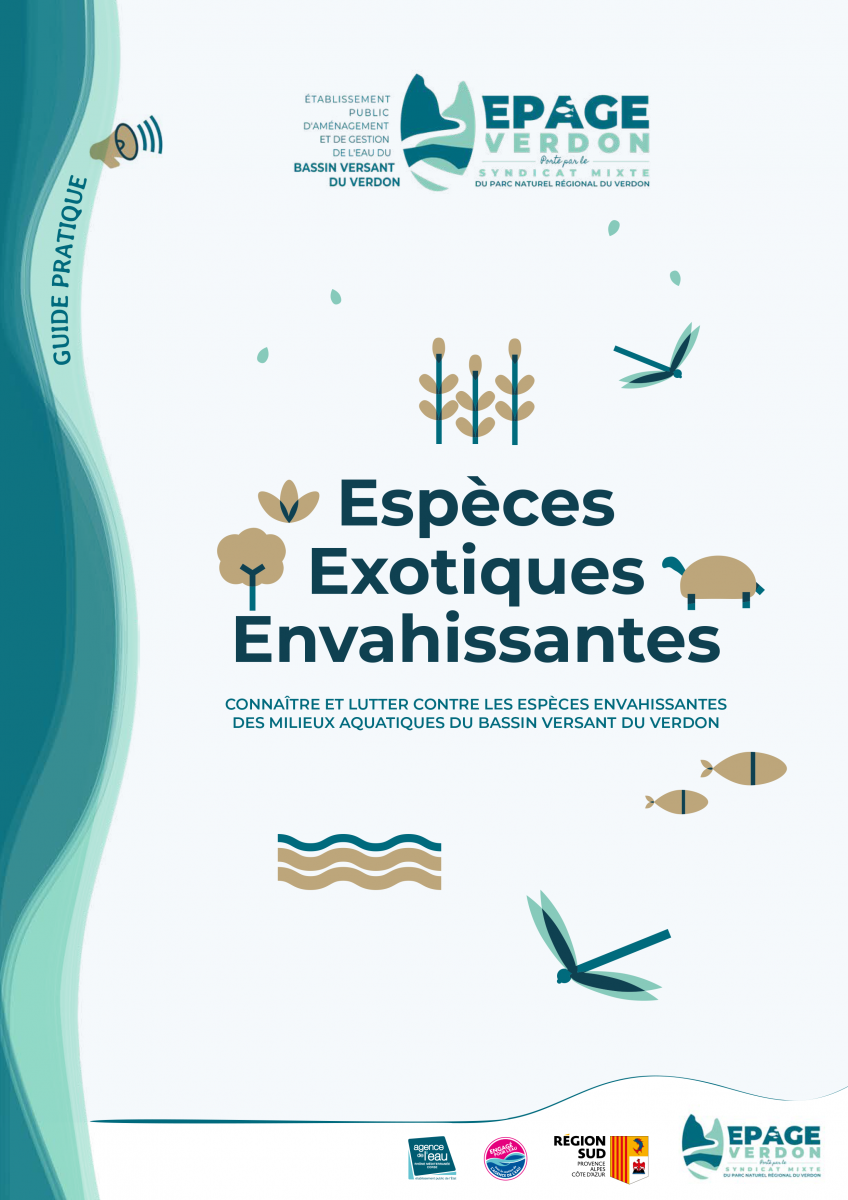En France, les cours d’eau sont définis selon deux types. Les cours d’eau « domaniaux » pour lesquels l’entretien est de la compétence de l’Etat comme les fleuves, et les cours d’eau « non domaniaux » où l’entretien est de la compétence des propriétaires riverains. C'est le cas du Verdon et de ses affluents.
La ripisylve est la végétation présente en bordure de la rivière (de ripa rive, et sylva forêt). Elle est composée d’arbres, d’arbustes et d’herbacées. Autrefois les cours d’eau étaient entretenus par les propriétaires riverains, car ils y trouvaient un intérêt économique (bois de chauffage, poissons…), et avaient la connaissance des risques en cas de manque d’entretien. Aujourd’hui, ce n’est bien souvent plus le cas. Suite au manque d’entretien de la plupart des cours d’eau français, une collectivité peut se substituer aux propriétaires privés, sous réserve de montrer l’intérêt général des interventions prévues. La programmation de travaux nécessite donc une enquête publique.
Il s’agit d’intervenir dans les zones à enjeu, afin de faire cohabiter un cours d’eau le plus naturel possible avec une ripisylve développée bénéfique au niveau écologique, et l’occupation humaine des vallées.
L'entretien de la ripisylve est assuré par l'EPAGE Verdon et est inclus à la compétence GEMAPI. Il est financé par les sept intercommunalités du bassin versant et par l'Agence de l'Eau. Cet entretien est réalisé annuellement en suivant une programmation sur 10 ans. La programmation actuelle s'étend de 2023 à 2032.
Les travaux d'entretien de la ripisylve répondent à divers objectifs
La sécurité publique : restaurer le libre écoulement des eaux, prévenir et diminuer les risques d’inondation et d’érosion.
 Les arbres tombés dans la rivière et les accumulations de bois (embâcles), mais aussi la végétation poussant dans le lit et sur les atterrissements, constituent autant d’obstacles à l’écoulement et peuvent provoquer des inondations, des érosions de berges, et une augmentation de la violence du courant pouvant aboutir à une incision du lit. Toutefois, les embâcles ne doivent être enlevés que si les enjeux le justifient, car ils ont un grand intérêt écologique (abris, caches…).
Les arbres tombés dans la rivière et les accumulations de bois (embâcles), mais aussi la végétation poussant dans le lit et sur les atterrissements, constituent autant d’obstacles à l’écoulement et peuvent provoquer des inondations, des érosions de berges, et une augmentation de la violence du courant pouvant aboutir à une incision du lit. Toutefois, les embâcles ne doivent être enlevés que si les enjeux le justifient, car ils ont un grand intérêt écologique (abris, caches…).
Il faut également prévenir la chute d’arbres dans le cours d’eau : une végétation en mauvais état sanitaire, vieillissante, ou mal adaptée en bordure de cours d’eau va avoir de nombreuses conséquences pour la stabilité des digues et des berges. Le basculement d’un arbre dans le cours d’eau va entraîner la formation d’un embâcle, d’une encoche dans la berge ou la digue, évoluant vers une anse d’érosion. Des abattages préventifs sont nécessaires.
Une gestion spécifique est également nécessaire à l’aval des grands barrages, car l’absence des petites et moyennes crues qui dans un milieu naturel rajeunissent régulièrement les milieux, favorise le développement de boisements dans le lit du cours d’eau.
Il s’agit aussi de gérer les atterrissements de matériaux dans certains secteurs (création ou réouverture de chenaux de crue…).
Le patrimoine naturel : maintien et la restauration des potentialités écologiques des cours d’eau et notamment des ripisylves et des annexes de la rivière.
Il existe des secteurs de cours d’eau où la végétation a disparu, a été dégradée ou a été remplacée par des espèces non adaptées voire envahissantes. Il est donc nécessaire d’intervenir afin de préserver, voire d’améliorer l’ensemble des fonctions de la ripisylve (élagage, abattage, coupes sélectives, plantation d’espèces adaptées, éradication des invasives…). Il est également intéressant de restaurer certains bras morts (zones de refuge ou de reproduction….). Les interventions peuvent aussi permettre de diversifier les faciès d’écoulement afin de restaurer l’écosystème et d’améliorer le potentiel piscicole, ou de restaurer les communications hydrauliques pour faciliter l’accès aux zones de frayères et améliorer la reproduction des espèces piscicoles.
Les usages liés à l’eau : valorisation des rôles touristiques, sportifs et paysagers des rivières et sensibilisation des usagers de l’eau.
Il s'agit de valoriser la ripisylve et le cours d'eau en termes paysagers, de faciliter l’accès au cours d’eau pour les activités sportives et de loisirs, de concilier les différents usages avec les enjeux écologiques.
GEMAPI dans le Verdon : l'entretien des cours d'eau en question.
Contacts des techniciens rivières :
Secteur bas Verdon, Artuby-Jabron : Olivier OLLER ooller@parcduverdon.fr
Secteur haut et moyen Verdon : Thomas GARNIER tgarnier@parcduverdon.fr