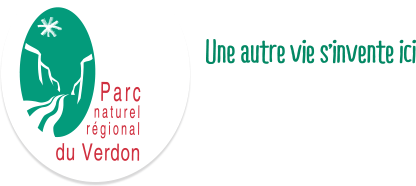Le castrum de Brauch et la chapelle Sainte-Maxime
Il est probable que le site actuel de Sainte-Maxime, où s’élève une chapelle de pèlerinage
portant ce même nom (Fig. 1), soit celui d’un village attesté au Moyen Âge et déserté avant
le XIVe siècle. Ce serait le castrum de Brauch, alors associé à une église paroissiale dédié à
saint Pierre et dont le territoire se développait sur la rive sud du Verdon, entre la rivière et le
relief du Grand Blé. Il est attesté dès 1033, lorsque ses possesseurs le donnent aux moines de Saint-
Honorat de Lérins. En 1237, ces derniers cèdent le domaine aux Templiers de la commanderie voisine
de Saint-Maurice (aujourd’hui, sur la commune de Montmeyan), tout en conservant quelques
prérogatives. Les Hospitaliers succèdent aux Templiers au début du XIVe siècle.
L’habitat de Brauch semble avoir été abandonné durant la première moitié du XIIIe siècle,
mais ses terres ont continué à être exploitées, soit comme pâturages pour les parties les plus
arides, soit pour les cultures dans le secteur de La Mourotte. L’église Saint-Pierre est restée
sous le contrôle des moines soldats jusqu’au XIVe siècle au moins.
Fig. 1. Vue aérienne du site de Sainte-Maxime, depuis le sud-ouest. La plateforme sommitale
accueillait sans doute une fortification. Le village se développait, en contrebas, à droite. La chapelle
actuelle, accolée à un édifice plus ancien, est visible à gauche. Le principal point d’accès au site se
situe au niveau de la tour carrée située à l’arrière-plan, aménagée en ermitage au XVIIIe siècle
(Cliché : Arnaud Ambroise).
Les limites du territoire de Brauch sont celles, sans doute, de l’actuelle enclave de Quinson
située sur la rive gauche du Verdon et d’une partie des terres de La Verdière, sur les pentes
du Grand Blé. Ces deux communautés ont réglé leurs droits d’usage respectifs en effectuant un
bornage dès 1252, puis à nouveau en 1275 et en 1383, et enfin lors d’un long procès, favorable à
Quinson, qui couvre une grande partie du XVIIIe siècle.
Il est à noter que l’on situe aujourd’hui l’ancien site de Brauch au lieu-dit La Grande Bastide
(commune de La Verdière). Cependant, aux XIIIe-XVe siècles, il est possible que celle-ci ait été
plutôt une ferme des Templiers, puis des Hospitaliers de Saint-Maurice, et qu’elle ait capté
tardivement le toponyme de Brauch après la disparition du castrum.
Quant au vocable de la chapelle Sainte-Maxime, attesté seulement aux Temps modernes, en
mémoire d’une sainte vénérée à Fréjus et à proximité de cette cité, il résulte
vraisemblablement d’une déformation de « saint Maxime », évêque et patron du diocèse de
Riez.
Thierry Pécout (Université Jean Monnet)
La construction de l’actuelle chapelle de Sainte-Maxime est attribuable au milieu du XIXe
siècle, ainsi que la rappelle la date de 1856 inscrite au-dessus de sa porte.
Le chevet de cet édifice prend appui sur une chapelle voûtée plus ancienne (de la fin du XVIIe
siècle ?) dont elle recouvre une partie des pièces annexes, préalablement arasées (Fig. 2). Ce
petit bâtiment, perpendiculaire à l’édifice de culte actuel, et jadis fermé par une paroi
ajourée en bois (Fig. 3), conserve les vestiges de son autel ainsi que ceux du décor peint qui
le surmontait. Les deux bâtiments ont été restaurés en 2021.
Fig. 2. Plan général de l’actuelle chapelle Sainte-Maxime (1856). Son choeur est établi sur l’extension
méridionale, arasée, d’une chapelle plus ancienne (Relevés : Lénaïc Riaudel, DAO : Martine
Fornassari).
Il est vraisemblable que l’église médiévale Saint-Pierre se situait dans le même secteur, mais
aucune trace n’en est actuellement perceptible. En revanche des vestiges ténus du village
qui lui était associé, établi sur des gradins naturels, sont visibles sur la pente sud-ouest de
l’éminence, au-delà d’une plateforme rocheuse qui pourrait avoir accueilli une fortification
aujourd’hui disparue.
Fig. 3. Mur gouttereau occidental de la chapelle Sainte-Maxime (à droite) et façade occidental de la
chapelle antérieure (à gauche), jadis fermée par une paroi ajourée en bois. Les jours d’affluence, cette
grille permettait de suivre les offices depuis l’extérieur du bâtiment (Relevés : Lénaïc Riaudel, DAO :
Martine Fornassari).
Les restes d’une « tour » carrée, située à l’entrée du site semblent correspondre à ceux d’un
ermitage, ainsi que le suggère la carte dite de Cassini établie au XVIIIe siècle. Un support de
croix en pierre, de forme tronconique, est encore visible au pied de la construction.
Philippe Borgard (Aix-Marseille Université)
Localisation des principaux toponymes mentionnés dans le texte
Partager :